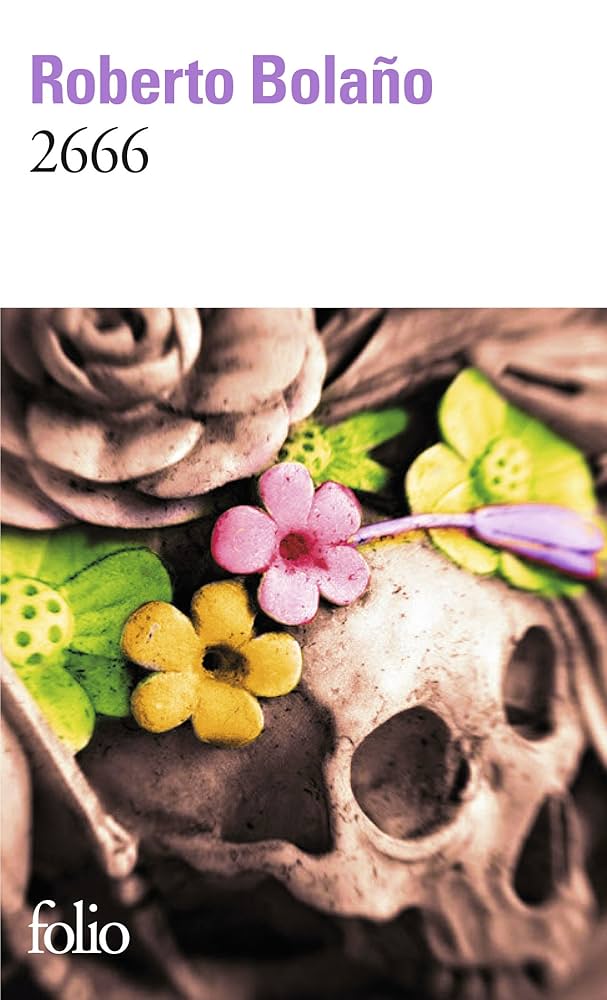
Attention ! Chronique Longue pour Livre fleuve. Installez-vous, prenez votre temps.
Sinon, passez votre tour.
Il faudrait pouvoir élargir le langage, créer de nouveaux mots, mixer des expressions linguistiques avec ses propres sentiments, faire exploser des néologismes, être créatif.
Pourquoi ? pour se mettre au niveau d’œuvres monumentales, des sculptures gigantesques comme le Colosse de Rhodes dans l’Antiquité ou la Statue de l’Unité en Inde, des peintures démesurées illuminant de beauté le plafond de la Chapelle Sixtine par Michel Ange, de films interminablement beaux et longs comme le « Napoléon » d’Abel Gance ou « le Seigneur des anneaux » de Peter Jackson , de mastodontes littéraires comme « les hommes de bonne volonté » de Romain Rolland et ses 27 volumes, « La recherche » de Proust et ses 2400 pages ou les plus de 1000 pages de « Belle du Seigneur » d’Albert Cohen. Par exemples.
Ou « 2666 » de Roberto Bolano et ses 1300 pages, « monstruosité » littéraire parue à titre posthume, dont je vais essayer de parler ici, tout en affichant d’emblée la couleur : ce livre est bien le monument littéraire dont parlent tous les palmarès sur lesquels invariablement il figure et les nombreux lecteurs conquis qui le partagent avec fougue.
Roberto Bolano est un poète et romancier chilien né en Espagne à Barcelone en 1953 et mort en 2003 à 50 ans seulement. Né d’un père routier et boxeur (ce qui a son importance dans ce livre) et d’une mère enseignante (pareil pour l’importance) il vit son enfance à Mexico. Scolarité difficile, il deviendra journaliste et militant de gauche. Très impliqué politiquement lors du coup d’État de Pinochet au Chili contre Salvador Allende, il sera même brièvement emprisonné. Militant trotskiste, inventeur du « Mouvement poétique mineur » que l’on pourrait rattacher au mouvement surréaliste, il va errer toute sa vie, alternant des petits boulots tout en écrivant de la poésie, puis de la fiction vers la quarantaine. De santé fragile, il meurt en 2003 d’une Insuffisance hépatique, probablement d’une cirrhose du foie. Il laisse une épouse espagnole et deux enfants, « sa seule patrie » nous dit-il.

Son œuvre est dense, bousculée, écrite en Espagnol, quasiment toute traduite en Français. « Les détectives sauvages », « Nocturnes du Chili » émergent d’une œuvre touffue écrite en quelques années seulement. Son portrait nous montre les photos d’un homme plutôt fragile, préoccupé, qu’on imagine soucieux et réservé, ce qui ne l’empêche pas de se lâcher dans ses récits.
« 2666 » est son livre culte paru à titre posthume, presque inachevé.
Bolano savait qu’il allait mourir lorsqu’il acheva son roman archi-tectonique , et prépara sa publication. Écrit autour de cinq fils narratifs, ce sont cinq textes d’importance et de longueur inégale, que l’auteur souhaitait voir publier en cinq fois, une par an, pour assurer à ses enfants des ressources financières pérennes. Heureusement son exécuteur testamentaire et sa famille ne s’y résoudront pas et le livre sera publié dans son intégralité. Heureusement, parce qu’il existe une cohérence, une unité autour de ce livre qui mérite d’être lu d’une traite pour en saisir l’intensité, la gravité, la construction d’une grande habileté, les ressorts dramatiques récurrents et éviter de s’extraire d’une ambiance et d’une atmosphère oppressante. Plusieurs interprétations ont été données et prêtées à débat pour expliquer le titre.
La plus simple et la plus crédible est celle-ci : « 666 » est le chiffre de la bête dans l’Apocalypse de Jean, la bête de l’Apocalypse dont la symbolique se retrouve aussi dans le Livre de Daniel.
666, c’est l’esprit de division qui règne dans le monde.
Ce qui divise les hommes, un chiffre métaphorique qui fait peur et qui a donné lieu à de multiples analyses savantes.
Le 2, en pole position est le chiffre rapporté à notre millénaire.
Ce titre se fond parfaitement avec l’histoire et se révèle comme un filigrane en philatélie.
Le roman est découpé en cinq parties qui vont toutes s’articuler autour d’un personnage qui servira de trace et de traque au livre, l’écrivain fantôme « Benno Von Archimboldi.
1- La première partie se déroule autour de quatre universitaires, un Français Pelletier, un Italien handicapé moteur Morini, un Espagnol Espinoza et une Anglaise Norton, qui vont se lier d’amitiés au fil de rencontres dont le principal motif est l’analyse, la mise en notoriété d’Archimboldi, le développement de son œuvre par des colloques spécialisés, des rencontres littéraires, dans l’espoir de le propulser un jour comme candidat au Nobel. Cette première partie nous dépeint un milieu et des personnages peu sympathiques, avant tout névrosés, obsédés par la reconnaissance de leurs pairs, arrogants, hantés par leurs publications mais aussi leurs partages sexuels. Se déroule une sorte d’enquête policière qui les conduira au Mexique, dans la ville fictive de Santa Teresa à la recherche d’indices, de pistes qui leur permettraient de retrouver l’écrivain. C’est un microcosme à la David Lodge que nous dépeint Bolano, avec beaucoup de sens dans le détail, la personnalité névrotique et perverse des personnages qui ne sont guère à leur honneur avec leurs boulons mal serrés !

2- La deuxième partie voit débouler Oscar Amalfitano qui décroche un poste de professeur de philosophie à l’université de Santa Teresa.
Pour donner le ton. « Quels livres lisez-vous d’habitude ? (lui demande Marco Antonio Guerra). Avant, je lisais de tout professeur, et en grande quantité, aujourd’hui je ne lis que de la poésie. La poésie seule n’est pas contaminée. Je ne sais pas si vous me comprenez professeur. La poésie seule, et encore pas toute, que ce soit clair, est un aliment seul et pas une merde. «
3- Dans la troisième partie, c’est un journaliste afro américain Fate qui va couvrir un combat de boxe entre un boxeur américain et un boxeur de seconde zone mexicain, un peu à l’arrache, le correspondant régulier du journal ayant été assassiné. On se croit par moments à la frontière mexicaine avec Donald Trump comme agent de la circulation. Il est le premier à s’intéresser aux meurtres en cascade à Santa Teresa, mais n’ira pas faute de moyens, au-delà des prémisses de son enquête.
4- La partie centrale du roman beaucoup plus longue nous fait pénétrer au cœur d’un fait divers horrible, réel, où plus de 2000 meurtres de femmes travaillant pour beaucoup dans des maquiladoras se sont déroulés sur plusieurs années dans la périphérie de Santa Teresa (s’appuyant sur ce qui s’est réellement passé dans la ville de Ciudad Juarez au Nord du Mexique dès 1993), dans des conditions similaires particulièrement macabres. C’est la partie à la fois la plus puissante du livre mais aussi la plus lassante. Bolano va nous dérouter et nous dépeindre pendant 300 pages une litanie d‘assassinats sauvages, de façon très clinique, médicale et policière à la fois, une police ratée aux blagues salaces et machistes, peu investie pour découvrir les auteurs, une justice corrompue aux basques de narco trafiquants dont l’empire ne cesse de s’étendre. Enfin une sexualité prégnante et débridée avec des répétitions de scènes qui font immanquablement penser au « Justine » du Marquis de Sade. Cette déclinaison autour du mal renvoie immanquablement le lecteur aux travaux de Hannah Arendt.
5- La dernière et cinquième partie est la plus passionnante, la plus humaine, la plus touchante aussi, relatant longuement l’enfance, l’adolescence puis la vie adulte de Hans Reiter que la carrière militaire va propulser sur le front de l’Est pendant la seconde guerre mondiale. C’est là qu’il découvrira sa vocation littéraire. Je n’en dirai pas plus pour ne pas spoiler l’histoire mais cette cinquième partie sert de ruban magnétique qui va regrouper les cinq parties du livre et lui donner son sens, sa singularité, sa cohésion et sa cohérence.
Ce livre n’est pas un roman fleuve. C’est un véritable torrent qui déferle du sommet d’un glacier pour gagner en puissance au fil de son ruissellement, débordant par moments de son lit pour tout arracher, défoncer et détruire autour de lui. C’est le livre global d’une pensée en souffrance de l’auteur, qui depuis le titre jusqu’au dernier mot aborde tous les sujets de l’existence humaine, l’amitié, la séduction, les apparences, la monstruosité du genre humain, l’absence de lois, la pauvreté, le féminicide, l’horreur de la guerre, mais aussi une forme d’espérance malgré tout. La vie quoi.
J’ai pensé à des tas d’auteurs en le lisant et selon les parties, d’Elena Ferrante à Albert Cohen, de Dostoïevski à Victor Hugo, d’Alexandre Dumas aux tragédiens grecs, de Shakespeare à Ionesco dans la démesure, mais aussi de Beckett à Kierkegaard.
A la sauce espagnole. C’est une longue dérive onirique sans jalons, ou en tous cas des repères qui peuvent rapidement s’effacer tant l’auteur émiette son récit par des fausses pistes, regorge de solutions qui n’en sont pas nous abandonnant en plein doute, seuls, au bord de son récit. Ce livre est aussi la transfiguration d’une immense solitude, chacun est perdu dans son histoire, où l’amour inconditionnel, seule valeur qui puisse nous rassembler, est au final peu présent. Livre sur la perdition et l’errance qui charrie beaucoup de tristesse, était-ce parce que Bolano se savait à la fin de sa courte existence ?
Si le livre est composé de cinq parties, il aurait pu se resserrer autour des 3 axes principaux, que sont la recherche universitaire de Benno Von Archimboldi, la tragédie centrale et l’atrocité des meurtres et du féminicide de Santa Teresa, et la rédemption de la troisième partie autour de Hans Deiter dont le lecteur devinera très rapidement qui il est réellement, partie qui m’a rappelé le « Molloy »de Samuel Beckett dans la solitude et les errements de Hans , sa façon de progresser dans son histoire personnelle sans boussole. C’est un livre avec des rythmes tragiques, comme dans une partition wagnérienne, des cassures, des lenteurs, des répétitions puis des reprises de souffle. C’est une fresque picaresque, qui embarque le lecteur d’abord hameçonné, puis happé et définitivement captivé et vampirisé par l’histoire, au point d’avoir toutes les peines du monde à s’en extraire.
J’ai rarement ressenti, un tel malaise physique en littérature, notamment dans la partie centrale véritable incantation au mal, consacrée aux meurtres dont il nous gave jusqu’à la nausée, contraignant le lecteur à faire des pauses toutes les 40 pages pour se ressourcer ailleurs. Livre tentaculaire qui tel un poulpe littéraire ne nous lâche jamais.
« Moi je vous comprends, dit Marco Antonio Guerra au Pr Amaltifano. Je veux dire, si je ne me trompe pas, je crois que je vous comprends. Vous, vous êtes comme moi, et moi, je suis comme vous. Nous ne trouvons pas bien. Nous vivons dans une atmosphère qui nous étouffe. Nous faisons comme si rien ne se passait, mais en fait ça se passe. Qu’est ce qui se passe ? on s’étouffe, merde. Vous, vous défoulez comme vous pouvez. Moi, je tabasse, ou je me laisse tabasser. Mais ce ne sont pas n’importe quels tabassages, ce sont des cassages de gueule apocalyptiques. «
« L’inutile s’impose non comme qualité de vie, mais comme mode ou signe distinctif de classe, et aussi bien la mode que les distinctions de classe ont besoin d’admiration, de révérence. Évidemment les modes ont une espérance de vie courte, un an, quatre ans au plus, et ensuite elles passent par toutes les étapes de la dégradation. Le signe distinctif de classe, au contraire, ne pourrit que lorsque le cadavre de celui qui le portait sur lui pourrit »
La poésie éclaire par instants la noirceur du livre.
« Il y avait longtemps que Kessler n’avait vu un crépuscule aussi beau. Les couleurs tourbillonnaient dans le couchant et cela lui rappela un crépuscule qu’il avait vu de nombreuses années auparavant au Kansas. Ce n’était pas exactement pareil, mais identique en ce qui concernait les couleurs. Il était là, se souvint-il, avec le sheriff et un camarade du FBI, et la voiture s’était arrêtée un moment, peut-être parce que l’un des trois devait descendre pour uriner, et c’est alors qu’il l’avait vu. Des couleurs vives à l’Ouest, des couleurs comme des papillons géants dansant tandis que la nuit avançait comme un boiteux à l’est. Allons-y chef, n’abusons pas de la chance. «
A la question, fondée, est ce que j’ai aimé ce livre je répondrai plutôt en posant la question différemment : « est ce qu’il faut lire ce livre ? et là ma réponse est oui, indubitablement. Parce que c’est une expérience littéraire, incertaine mais nécessaire, physique et quasiment mystique dans sa façon d’approcher aux racines du mal, telles que le conceptualise Hannah Arendt dans sa banalisation du mal.
Il faut je pense de la patience, de l’exigence, un brin de désinvolture pour ne pas se dire tiens là je lis un chef d’œuvre, non, une forme d’humilité et de respect pour l’auteur dont le texte traversera les époques telle une épopée incendiaire. On se déplace dans cette histoire avec l’impression de gravir sans prises une montagne à mains nues avec la prudence d’un démineur, se disant je traverse l’obscurité certes, mais le Graal est au bout.
Pour conclure cette (trop) longue chronique j’ai eu une impression étrange lors des cent dernières pages, le sentiment au fur à mesure que la fin se précisait, de voir l’histoire reculer toujours un peu plus comme si elle ne devait jamais se terminer. Livre à tiroirs, livre gigogne, livre souvent écrit en trompe l’œil pour nous égarer puis d’un paragraphe sec nous rattraper par le col de la chemise et nous remettre dans le droit chemin. Jamais le terme de Lignes de Fuites n’aura été plus approprié pour parler de « 2666 ». J’aurais aimé avoir un livre sur ce livre, savoir comment Bolano travaillait, avait-il un plan dans sa tête, ou bien courrait il lui aussi à perdre haleine après ses personnages, comme Sisyphe poussant son rocher qu’il convoque, lucide, vers la fin de son récit, confirmant par là même le caractère nihiliste de son œuvre.
Je pense avant de partir, à une phrase connue du philosophe Gaston Bachelard qui disait dans « la poétique de l’espace « , « Tout livre bien commencé doit être immédiatement continué. Tout bon livre achevé doit être immédiatement relu. «
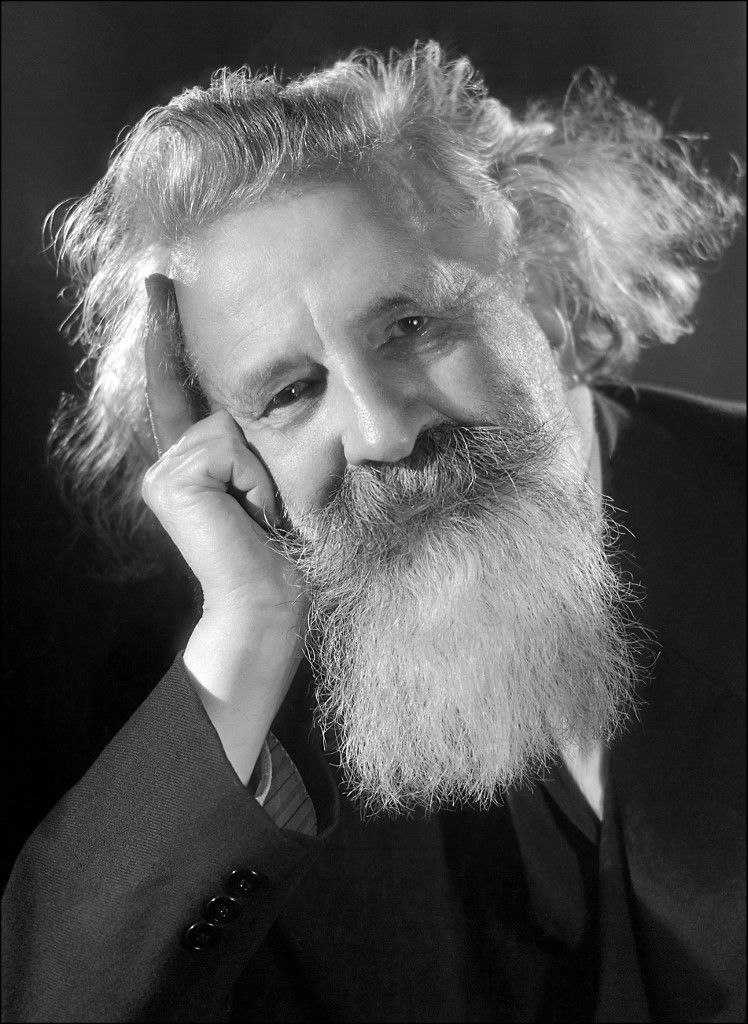
Alors immédiatement, probablement pas, mais un jour certainement.

Roberto Bolano
2666
Éditions Folio
1359 Pages
2004
Il nous faut, forcément, en savoir davantage.
